Agriculture saharienne - Le Sud, le potager de l’Algérie !
![Paysage de Ghardaia]()
L’agriculture saharienne n’est plus au stade de projet. C’est une réalité tangible. Aujourd’hui, plusieurs régions du pays
sont approvisionnées en fruits et légumes depuis Biskra, Ouargla, Adrar et Laghouat.
L’autosuffisance alimentaire constitue l’un des principaux objectifs de la politique agricole tracés par notre pays pour les
prochaines années. Mais cela «ne sera pas facile à réaliser». Et pour cause : la terre, l’eau et la main-d’œuvre, entre autres, posent problème au niveau des régions à fort potentiel
agricole.
Que faudra-t-il alors faire pour mettre fin à notre dépendance vis-à-vis de l’Europe en matière de produits agricoles ? Pour
Mustapha Chaouch, directeur de Krizalid Communication, qui organise le Salon de l’agriculture saharienne et steppique (Sud’Agral), la solution consiste à encourager l’agriculture dans le
Sud.
«Le Sahara est l’avenir de l’Algérie», dit-il avec beaucoup de conviction. De son avis, toutes les conditions d’une
agriculture performante sont réunies dans cette région du pays : «Il y a la terre, l’eau et la lumière, soit les trois éléments essentiels à toute culture.» De son avis, l’agriculture saharienne
a «tout naturellement» connu un boom extraordinaire, ces dernières années. «A Biskra par exemple, il y a d’immenses surfaces qui sont cultivées», a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse
qu’il a animée à l’effet de présenter la 6e édition de Sud’Agral.
L’agriculture saharienne n’est plus au stade de projet, mais c’est une réalité tangible. Les projets d’investissement lancés
jusque-là ont donné de très bons résultats et, aujourd’hui, plusieurs régions du pays sont approvisionnées en fruits et légumes à partir de Biskra, Ouargla, Adrar et Laghouat entre autres,
notamment en hiver.
Pour Mohammed Selles, président du comité d’organisation de Sud’Agral-2010, le Nord ne produit plus. «Où est la Mitidja ? Où
sont les vallées d’Oran et d’Annaba ?», s’interroge-t-il.
Par ailleurs, il soulignera que la plupart des produits agricoles que l’on consomme aujourd’hui proviennent du Sahara.
«Quand on se rend au marché, on y trouve tous les légumes à n’importe quelle période de l’année. Ce qui n’était pas le cas
dans le passé. C’est le fruit de l’agriculture saharienne», explique-t-il.
Un «bond qualitatif» dans les années à venir
Dans une allocution prononcée au cours du séminaire national sur l'eau dans l'agriculture saharienne organisé en mai 2010 à
El-Oued, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Rachid Benaïssa, a indiqué que l'agriculture saharienne connaîtra dans les années à venir «un bond qualitatif au regard des
efforts consentis par l'Etat dans ce cadre». Selon M. Benaïssa, il est question de consacrer quelque 300 000 hectares de terres agricoles dans le Sud à la céréaliculture. «C’est l’un des
objectifs que nous nous sommes fixés», a-t-il précisé.
Toutes les cultures réussissent au Sahara
Particularités n D’aucuns estiment que les fruits et légumes produits au Sahara, à l’instar de la pomme de terre d’El-Oued et
de l’orange d’El-Ménéa, dans la wilaya de Ghardaïa, sont de très bonne qualité.
L’agriculture saharienne ne manque pas d’atouts. Il faut dire que le Sud regorge de surfaces agricoles qui ne demandent qu’à
être exploitées. Aussi le sol dans cette région du pays est-il riche en oligo-éléments, ces éléments minéraux purs nécessaires à la vie de tout organisme, mais aussi en ressources hydrauliques.
«Contrairement à certaines idées reçues, il y a plus d’eau dans le Sahara que dans le Nord», précise M. Chaouch.
Selon M. Selles, ces ressources sont à même de subvenir à tous les besoins d’une agriculture performante pour peu qu’elles
soient utilisées de façon rationnelle. Autre atout de l’agriculture saharienne : l’énergie solaire dont le potentiel est énorme. Sur un autre plan, d’aucuns estiment que les fruits et légumes
produits au Sahara, à l’instar de la pomme de terre d’El-Oued et de l’orange d’El-Ménéa, dans la wilaya de Ghardaïa, sont de très bonne qualité. «Ce sont des produits qui ont un goût à part, que
l’on ne retrouve nulle part ailleurs», commente le président du comité d’organisation de Sud’Agral-2010. «Ils sont très appréciés ailleurs en plus», ajoute-t-il, non sans rappeler l’expérience
d’un opérateur privé qui a exporté de la courgette en France en 2005 au prix de… 9 euros le kilo !
«Cela donne une idée sur les profits que l’on peut faire dans l’agriculture saharienne. Malheureusement, nous ne savons pas
exporter», regrette cet ancien cadre du ministère de l’Agriculture. Selon lui, le rendement de la terre au Sahara est, de très loin, supérieur à celui des terres du Nord. Pour les céréales par
exemple, au Sud, le rendement est de 70 quintaux à l’hectare contre 4 à 12 quintaux à l’hectare dans le Nord. S’agissant de la pomme de terre, l’écart est encore plus frappant : 400 quintaux à
l’hectare pour les régions du Sud contre 120 uniquement pour celles du Nord.»
Il y a lieu de noter également le succès de l’expérience de plantation d’oliviers à El-Oued où une récolte de 9 472 quintaux
d'olives a été enregistrée au titre de la saison agricole 2009/2010, selon des statistiques de la Direction locale des services agricoles (DSA).
A ces atouts naturels viennent s’ajouter les avantages accordés par l’Etat aux investisseurs dans le cadre des différents
programmes de développement…
Pour une plus grande maîtrise des techniques
Les problèmes auxquels sont confrontés les investisseurs dans ce créneau ne sont pas insurmontables.
Le développement de l’agriculture saharienne est principalement confronté au problème de l’eau. Certes, il existe dans le Sud
d’importantes ressources hydrauliques, mais celles-ci ne sont pas renouvelables. Leur exploitation excessive, ces dernières années, a d’ailleurs entraîné une remontée des nappes phréatiques et
une salinisation des sols. Autre obstacle auquel font face les investisseurs dans ce créneau : l’éloignement des régions de production de celles de consommation.
La mobilisation de moyens de transport est dans ce cas nécessaire, ce qui a pour effet d’augmenter le prix de revient des produits agricoles provenant du Sud.
Les fruits et légumes à Tamanrasset et à Illizi, pour ne citer que ces wilayas de l’extrême Sud du pays, sont chers pour la
simple raison qu’ils ne sont pas produits localement. Ils proviennent dans leur quasi-totalité des régions situées un peu plus au nord. Par ailleurs, les habitants du Sud ne maîtrisent pas les
techniques spécifiques à l’agriculture saharienne, eux qui ont toujours vécu de l’élevage. A ce propos, le directeur de Krizalid Communication, qui organise Sud’Agral, révèle que lors de la
troisième édition de ce salon, organisée en 2003, de nombreux habitants de la région «ont pris attache avec nous pour savoir quelles sont les cultures qui peuvent réussir dans le Sahara».
«Nombre d’entre eux ont pris le soin de ramener avec eux un peu de terre et d’eau de leur région pour analyse et pour savoir
quel type de culture adopter», poursuit-il. Toujours est-il que ces obstacles ne sont pas insurmontables. Ainsi la réutilisation des eaux usées après épuration et la généralisation des techniques
qui permettent d’économiser l’eau permettraient-elles de résoudre le problème du manque d’eau.
Quant au transport des produits agricoles du Sud vers le Nord, il sera facilité après concrétisation des programmes
d’extension des réseaux routier et ferroviaire dans les prochaines années. «Sans cela, les gens sauront se prendre en charge», souligne M. Selles.
Enfin et s’agissant de la non maîtrise des techniques spécifiques à l’agriculture saharienne, des campagnes de sensibilisation
et d’explication régulières devraient suffire à convaincre les populations du Sud à se lancer dans ce créneau.
Ces «paradis verts» !
A Laghrous, dans la wilaya de Biskra, des commerçants viennent des 48 wilayas du pays pour s’approvisionner en tomates,
poivrons et autres courgettes.
On ne peut parler d’agriculture saharienne sans évoquer ces vergers qui ont fait leur apparition à Biskra, El-Oued, Laghouat,
Djelfa et Ouargla. En quelques années, ces régions sont devenues de véritables «paradis verts», où l’on cultive toutes sortes de fruits et légumes.
Ceux qui les ont connues jadis doivent avoir du mal à les reconnaître aujourd’hui tant leur mutation a été profonde. «Ce que
j’ai vu récemment à Biskra m’a vraiment impressionné. Je n’en reviens pas franchement, on se croirait en pleine Mitidja. Quand j’ai visité la région dans les années 1990, il n’y avait que du
sable. Mais les choses ont radicalement changé depuis», témoigne Abderrahmane, 61 ans, qui exerce en tant que conseiller pour le compte d’une entreprise privée du secteur de
l’agroalimentaire.
«Il faut se rendre à Laghrous, dans la wilaya de Biskra, pour voir le potentiel de l’agriculture saharienne. Pour moi, cette
commune est le potager de l’Algérie. Des commerçants y viennent des 48 wilayas du pays pour s’approvisionner en tomates, poivrons, courgettes, dattes et j’en passe», souligne, de son côté, le
président du comité d’organisation de Sud’Agral-2010. «La région d’El-Ménéa mérite également d’être visitée», poursuit-il. Selon lui, néanmoins, l’agriculture saharienne peut réussir dans
n’importe quelle région du Sud : «Tout le Sahara peut être cultivé.» Aussi surprenant que cela puisse paraître, les investisseurs dans ce créneau sont pour la plupart originaires du nord du pays.
«Il s’agit le plus souvent d’industriels qui ont acheté des terres dans le Sud», note M. Selles, non sans préciser que les premiers à avoir tenté l’expérience sont natifs de Kabylie
surtout.
Et d’expliquer que les populations locales n’ont pas de traditions agricoles : «Elles ont toujours fait de l’élevage.»
Toutefois, «elles sont en train de s’intéresser de près à l’agriculture saharienne», souligne-t-il encore. Ainsi et à titre d’exemple, certains habitants se sont lancés dans l’apiculture, que
l’on a crue, à tort, «incompatible» avec le climat saharien. C’est dire que toute activité agricole peut réussir dans le Sud !
54 exposants à Sud’Agral
Depuis 2001, un salon dédié à l’agriculture saharienne est organisé chaque année dans une wilaya du Sud. La 6e édition de
Sud’Agral, qui s’est déroulée du 19 au 22 décembre 2010 au complexe sportif El-Alia de Biskra, a vu la participation de 54 exposants, en augmentation de 60% par rapport à la précédente édition.
«Ceci est un signe révélateur de l’intérêt porté à cet événement et de la prise de conscience de l’importance stratégique du développement de l’agriculture dans les zones arides et semi-arides»,
avaient indiqué les organisateurs de cette manifestation au cours d’une conférence de presse. Outre les opérateurs économiques, des organismes d’encadrement et des instituts de recherche et de
formation ont pris part à ce salon. Vulgariser les techniques agricoles et pastorales spécifiques aux régions arides, désertiques ou semi-désertiques et d’échanger le savoir-faire et les
expériences réussies en la matière sont les principaux objectifs de ce salon.
Source Infosoir Kamel Imarazène
Le Pèlerin









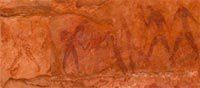














 Le Casino de Biskra
Le Casino de Biskra Le Balcon de Rhoufi
Le Balcon de Rhoufi