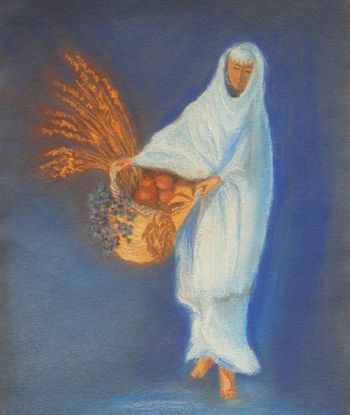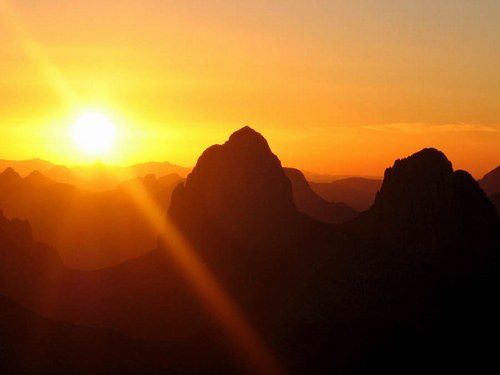Une perle dans le désert
![Nouvelle-Ville-HassiMessaoud.jpg]()
La ville nouvelle de Hassi Messaoud devant être réalisée d’ici à 2016 reflétera l’image d’une oasis urbaine unique dans son
genre en Algérie, lorsqu’on se réfère à son plan d’aménagement et d’urbanisme. Selon des estimations officielles, cette ville devrait être construite dans 96 mois pour un coût approximatif de six
milliards de dollars, même si le coût réel du projet ne pourra pas être déterminé avant la finalisation de la phase études, selon l’Établissement de la ville nouvelle de Hassi Messaoud
(EVNH).
Couvrant une superficie 4 483 hectares sur le territoire de la commune de Hassi Messaoud, la ville nouvelle va remplir toutes
les conditions fonctionnelles et d’intégration environnementale appropriée dans une atmosphère communautaire de qualité, selon l’Etablissement de la ville nouvelle de Hassi Messaoud
(EVNH).
Le nouveau Hassi Messaoud, situé à équidistance (80 km environ) des villes de Ouargla, Touggourt et Hassi Messaoud, comprendra
une grande variété de zones résidentielles attractives puisqu’elle sera dotée de tous les équipements d’un centre urbain de haut niveau, dont les fonctions de base sont les activités
énergétiques, universitaires, culturelles, sportives et de loisirs.
Ainsi, le programme urbain de cette oasis pétrolière, qui va coûter près de six milliards de dollars, prévoit la réalisation
de deux programmes d’habitats individuels et collectifs et d’un troisième pour les équipements d’accompagnement.
Le programme habitat destiné pour une population de 80 000 habitants comprend la réalisation de 7 929 logements individuels et
10 446 logements collectifs. Quant au programme des équipements, il inclut toutes les infrastructures nécessaires pour accueillir la population de l’ancienne ville, déclarée zone à risques
majeurs par les autorités en raison de son implantation sur le périmètre du plus grand champ pétrolier du pays (Hassi Messaoud).
Le plan urbain de la ville nouvelle de Hassi Messaoud prévoit la réalisation d’infrastructures pour les secteurs
respectivement de l’éducation nationale (43 infrastructures), l’énergie (12), santé de la population (30), jeunesse et sport (37), culture (27), administrations (27), finances et assurances (5),
commerce (253), tourisme (3), culte (6), divers (7) en plus d’une gare routière et d’une décharge publique.
Pour le secteur de l’éducation, l’EVNH, chargé de la concrétisation du projet, prévoit la construction de 10 crèches et
jardins d’enfants, 22 écoles primaires, 6 collèges d’enseignement moyen, 3 lycées, un institut technologique et un centre de formation professionnelle. Quant au secteur de l’énergie, il est prévu
notamment la réalisation d’un institut algérien du pétrole, d’un centre de recherches et développement de Sonatrach et 10 sièges régionaux pour cette entreprise et ses différentes
filiales.
La ville nouvelle comprendra également 2 hôtels, un parc de loisirs et des sièges administratifs qui concernent pour
l’essentiel des sièges pour les corps de la sûreté urbaine, la gendarmerie, les douanes ainsi que des bâtiments administratifs destinés à accueillir, notamment, le chef-lieu de Daïra, l’APC,
l’OPGI, l’EPLF. Le secteur de la culture n’est pas en reste dans ce programme puisqu’il est prévu, notamment, la construction de 6 maisons de jeunes, 4 centres culturels, 5 salles de cinémas, un
amphithéâtre, un théâtre et un musée.
Il est également prévu la réalisation de 31 terrains de jeux et sport en plein air, 2 piscines et 2 salles de sport
spécialisées. Concernant le secteur de la santé, il est inscrit dans ce programme la réalisation d’un hôpital de 240 lits, de 4 maternités urbaines, de 3 polycliniques, de 4 centres de santé, de
6 centres médico-sociaux, d’un foyer pour personnes âgées, de 6 cliniques dentaires, 4 pharmacies et un orphelinat.
Le consortium algéro-coréen, Dongmyeong-Samankun Won-Berep, s’empare du projet
Le projet de la ville nouvelle de Hassi Messaoud est entré dans sa phase de réalisation avec le lancement fin janvier des
études d’aménagement et d’urbanisme, a-t-on appris, hier, auprès de l’organisme chargé de la gestion du projet.
Le consortium algéro-coréen, « Dongmyeong-Saman-Kun Won-BEREP », dont le marché lui a été attribué par l’Établissement de la
ville nouvelle de Hassi Messaoud (EVNH), a entamé fin janvier dernier les travaux liés aux études d’aménagement et d’urbanisme du site devant abriter le futur pôle pétrolier algérien, a indiqué à
l’APS le directeur de l’EVNH, Mourad Zeriati.
Ce groupement, qui a proposé un montant de 916,71 millions de dinars pour un délai de huit mois, est composé des firmes
sud-coréennes Dongmeyong Engineering, chef de file avec une part de 45%, Saman Corporation (25,5%) et Korea Land & Housing Corporation (7,5%), ainsi que le bureau algérien d’études et de
recherche d’ingénierie des projets (BEREP) (25%), précise Mourad Zeriati. Il a été, ainsi, retenu par l’EVNH à la faveur de son offre financière jugée la plus avantageuse sur un total de 11
soumissionnaires qui étaient en lice pour décrocher ce marché.
Les études en question ont, notamment, pour objectifs de générer le plan d’aménagement général de la ville nouvelle qui
intègre le périmètre de la ville et de sa zone d’activités logistiques, élaborer les études d’avant-projet détaillées (APD) de la voirie et des réseaux divers (VRD), élaborer le plan de mise en
oeuvre du projet et établir un règlement urbain régissant la production du sol urbain et du cadre bâti.
Il s’agit, aussi, d’élaborer l’ensemble des plans et documents techniques à soumettre pour examen et avis à la collectivité
territoriale de Hassi Messaoud, au conseil exécutif de la wilaya de Ouargla et à la commission interministérielle créée à cet effet, conformément aux dispositions du décret exécutif du 16 février
2011 fixant les conditions et modalités d’initiation, d’élaboration et d’adoption du plan d’aménagement de la ville nouvelle.
Le package contractuel du marché avait été paraphé, le 11 janvier, par le ministère de l’Énergie et des Mines, en sa qualité
de maître d’ouvrage du projet et le consortium algérocoréen, selon l’EVNH.
Par ailleurs, une fois la nouvelle ville réalisée, l’actuelle recouvrera sa vocation d’origine en abritant exclusivement les
structures et installations énergétiques et industrielles à l’instar des zones de Skikda et d’Arzew, avait récemment expliqué à l’APS, M. Zeriati, rappelant que le décret présidentiel de 2004
portant création de la ville nouvelle de Hassi Messaoud avait interdit toute extension urbaine ou commerciale.
Hassi Messaoud : Zone à risque majeur
Cependant, le Centre national du uegistre du commerce (CNRC) a annoncé, le 31 janvier dernier, la levée du gel des
immatriculations au registre du commerce pour la zone de Hassi Messaoud suite à la publication au Journal officiel N° 68 du décret n°11-441 du 14 décembre 2011 modifiant et complétant le décret
exécutif n° 05-127 du 24 avril 2005, déclarant Hassi Messaoud comme zone à risques majeurs.
Ainsi, ce décret donne au wali de Ouargla la prérogative d’accorder des autorisations concernant les activités et les
investissements à caractère industriel, commercial, touristique, agricole comme il pourrait permettre l’octroi de permis de construire ou de concessions qui ne soit pas lié directement à
l’industrie des hydrocarbures.
Le wali peut, également, sous réserve du respect des distances par rapport aux installations d’hydrocarbures, autoriser la
construction d’établissements scolaires et de formation professionnelle, d’établissements de santé, d’infrastructures pour l’administration locale ainsi que de programmes de logements publics. Il
peut aussi permettre la réfection et l’extension des réseaux routiers de la localité, des réseaux d’alimentation en eau potable, électricité et gaz ainsi que des réseaux d’assainissement.
Ces autorisations peuvent être accordées après avis d’un comité de suivi, présidé par le wali, qui veille à préserver la
sécurité des installations de l’industrie et des gisements d’hydrocarbures à l’intérieur de la zone de Hassi Messaoud. Selon des estimations officielles, cette ville devrait être construite dans
96 mois pour un coût approximatif de six milliards de dollars, même si le coût réel du projet ne pourra être déterminé avant la finalisation de la phase études, selon l’EVNH. La ville nouvelle de
Hassi Messaoud comprendra un îlot énergie qui constituera le quartier général des compagnies pétrolières opérant sur les champs pétroliers avoisinants.
Il est, également, prévu des immeubles administratifs, des instituts universitaires, des centres de formation, de recherche et
de développement, des lieux et centres de culte, des infrastructures, équipements et établissements du sport et de la jeunesse. La future ville du plus grand champ pétrolier du pays comprendra
aussi des zones d’activités destinées à la production de biens et services liés aux activités énergétiques et universitaires, selon les grandes projections de ce projet.
Source Le Financier Fawzi Khemili
Le Pèlerin